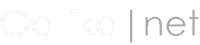Une prof un peu raide, un cours de français ou d’histoire, une élève qui s’ennuie, un clash… et un mot qui claque : « OK, boomeuse ! ».
Cette courte vidéo, relayée sur les réseaux sociaux, a de quoi faire sourire… ou grincer des dents. Elle offre pourtant une mine d’or pédagogique pour quiconque débute dans l’enseignement. Car derrière l’apparente anecdote se cache tout un cours sur la posture, l’autorité, la relation et ce qu’on fait (ou pas) quand la classe bascule.
Lana : C’est le cours le plus chiant de la terre. La Meuf elle a 60 ans ou quoi ?
Voisin de Lana : Oui, c’est vrai qu’on s’ennuie de ouf.
Prof : Prenons par exemple le mot « guerre »…du vieux francique « werra »… qui signifie « querelle ».
Lana : Qui trouve son origine dans l’étymologie heu de la bouillabaisse française.
Prof : Tu veux nous dire quelque chose, Lana ?
Lana : Non, je… je sais pas moi, mais on pourrait pas étudier un truc un peu plus actuel ?
Prof : Heu... Et bien l’étymologie d’un mot peut vous servir à bien l’orthographier. Et ça, je crois que c’est très actuel.
Lana : OK… boomeuse [3] !
Prof : Lana, le respect, en fait, on en a déjà parlé. Bon ! L’étymologie peut également vous servir à comprendre le sens des mots.
Lana : Bien sûr… boomeuse !
(Rires)
Prof : Non, mais là c’est bon. Ça. Suffit ! Je reprends pas le cours tant que tu t’es pas excusée.
Lana : Mais je vais pas m’excuser pour une blague, madame…
Prof : Très bien.
Le contenu : pertinent mais mal embarqué
La prof commence son cours par un exemple d’étymologie : « le mot guerre vient du vieux francique werra… ».
Elle est techniquement irréprochable. Mais la scène montre une déconnexion nette entre le contenu (linguistique, historique, abstrait) et les attentes implicites des élèves : plus de concret, plus d’actualité, plus de rythme.
Ce que ça nous apprend :
Un bon contenu ne suffit pas. Ce qui compte, c’est le point d’entrée, le cliquet d’attention : Pourquoi ce mot-là, aujourd’hui, avec eux ?
Comment faire mieux :
Lancer le cours avec une question : Quels sont les mots de la guerre qu’on utilise tous les jours sans s’en rendre compte ? (déclarer la guerre à son réveil, cyberattaque, zone de conflit, etc.). En passant, observe que la prof interrompt souvent son discours (soit disant) pour que des élèves complètent l’une ou l’autre de ses phrases... mais n’attend jamais suffisamment longtemps pour qu’un élève puisse intervenir.
Les postures : quand le corps parle aussi
La prof reste droite, rigide, les bras proches du corps, le regard fixe.
Son ton est neutre, presque désengagé. Elle traverse le désaccord sans réelle variation de voix.
Pendant ce temps, l’élève (Lana) est vivante, expressive, drôle, provocante. Elle détourne, mime, relance. Et son voisin approuve. La classe est avec elle.
Ce que ça nous apprend :
Quand le non-verbal de l’élève est plus vivant que celui de la prof, l’attention bascule. Même avec un bon contenu, la posture de la prof gagne ou perd la classe.
Une façon d’ajuster le tir :
Travaille ton entrée en scène comme un acteur : variation de voix, mobilité dans la salle, regard circulaire, respiration calme. C’est peut-être du théâtre mais c’est aussi et surtout de la pédagogie.
L’humour, la provocation… et toi, tu fais quoi ?
Lana lance : « Qui trouve son origine dans la bouillabaisse française… ».
Puis, quelques instants plus tard : « Boomeuse ! ».
C’est une attaque ? Oui. C’est de l’humour ? Aussi. C’est public, répété, assumé, relayé par le rire collectif.
Et la prof ? Elle s’accroche à son cours. Elle justifie, tente de recentrer : « L’étymologie, c’est utile pour l’orthographe… ».
Puis elle bloque : « Je reprends pas tant que tu t’es pas excusée. »
Mais l’élève ne s’excuse pas.
Tout va certainement mal se terminer.
Ce que ça nous apprend :
Il ne suffit pas d’avoir raison. Il faut choisir son moment et savoir quand ne pas s’obstiner.
Bloquer un cours pour obtenir des excuses, c’est une prise d’otage pédagogique : si l’élève ne cède pas, c’est l’adulte qui perd.
À éviter donc :
Ne jamais formuler une exigence que tu n’es pas sûre de pouvoir faire respecter.
Face à une provocation, plusieurs chemins :
– Ignorer (si c’est vraiment faible ou isolé) avec le sourire
– Reporter la discussion après le cours (le moins souvent possible) : « Tu restes deux minutes à la fin du cours, Lana. Là, je continue. »
– Détourner par l’humour (« C’est boomer d’orthographier correctement ? »)
Le respect : pas une question de punition
Ce que Lana fait, ce n’est pas qu’un gag. Elle joue avec le pouvoir symbolique. Elle tente de ridiculiser l’adulte aux yeux de la classe. Et la classe rit. Ce n’est pas nouveau : on appelle ça une mise à l’épreuve de l’autorité.
Mais le plus intéressant, c’est que la prof ne réagit pas au mot lui-même : elle ne demande pas « Tu peux expliquer ce que tu entends par là ? », ni « Pourquoi tu me dis ça ? ». Elle ne décortique pas, elle ne cadre pas. Elle veut juste que ça cesse.
Ce que ça nous apprend :
L’autorité ne se décrète pas. Elle se nourrit du cadre posé, des réponses données, de la capacité à tenir sans surréagir.
Piste concrète :
Formule ton cadre avant qu’il ne soit transgressé.
Ex. : « Tout est permis, sauf l’irrespect. L’humour oui, mais pas au détriment d’un camarade ou d’un adulte ».
Ce que cette scène nous enseigne vraiment
– Ne jamais se reposer uniquement sur un savoir. Ce qui compte, c’est l’entrée dans ce savoir.
– L’humour est une arme redoutable, pour les élèves comme pour les profs. Mais il faut savoir doser.
– L’autorité n’est pas une posture rigide. C’est un art d’être ferme sans perdre la relation.
– On ne gagne pas une classe contre un élève. On la gagne avec lui, ou pas du tout.
Donc oui, la prof de la vidéo aurait pu faire autrement. Mais elle nous rend service : elle nous offre un miroir, à travers lequel réfléchir à nos propres gestes, nos mots, nos silences et la part d’humanité qu’on met dans nos cours. Et si être « boomer », au fond, c’était juste résister à l’époque ? Et si enseigner, c’était traverser tout ça sans perdre le cap ? [4]
__________
[1] Boomeuse = femme née entre 1946 et 1964, issu de l’anglais « baby boomer ».
[2] … Et je suis bien placé pour poser ces questions : j’en suis un, de boomer. Avec pas mal de rides, des souvenirs de craie sur les doigts… et une fascination intacte pour TikTok, quand il devient matière à réflexion pédagogique.
[3] Boomeuse = femme née entre 1946 et 1964, issu de l’anglais « baby boomer ».
[4] … Et je suis bien placé pour poser ces questions : j’en suis un, de boomer. Avec pas mal de rides, des souvenirs de craie sur les doigts… et une fascination intacte pour TikTok, quand il devient matière à réflexion pédagogique.
Et toi, tu aurais réagi comment ?
Si tu étais la prof ?
– Tu ignores ?
– Tu souris ?
– Tu exclus ?
– Tu en fais un cas d’école ?
Et si tu étais Lana ? Qu’est-ce que tu cherches vraiment ?
– À rire ?
– À briller ?
– À exister ?
Parce que parfois, ce qu’on appelle « insolence », c’est juste une demande d’attention.
Cette scène peut servir de point de départ pour une formation, une analyse de pratique, un atelier en formation initiale. Ça t’intéresse ?